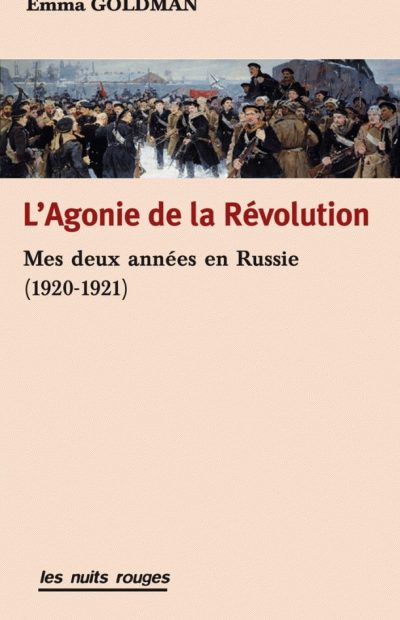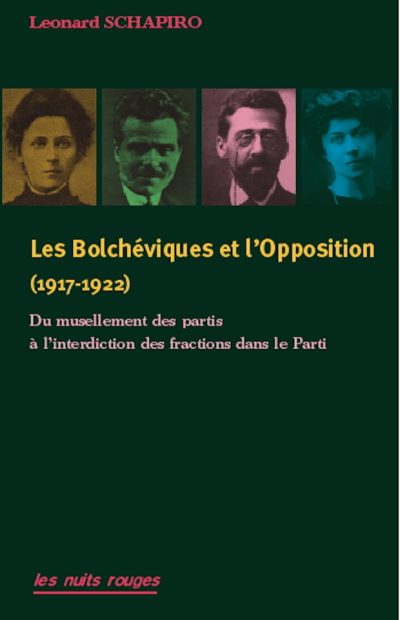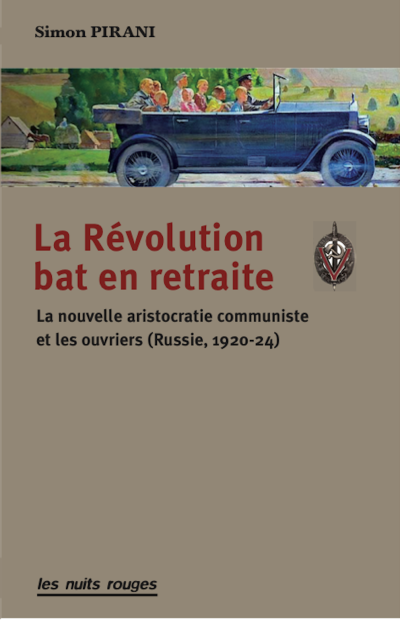Cronstadt 1921
Depuis un siècle, les léninistes et les autres tendances du mouvement ouvrier se déchirent sur la répression de la révolte des marins de l’avant-port de Pétrograd en mars 1921. Ces dernières la présentent comme « le crépuscule sanglant des soviets », tandis que les premiers affirment l’impérieuse nécessité qu’avaient les bolchéviques de réduire la forteresse, malgré le bien-fondé partiel (reconnu par certains d’entre eux) de leurs demandes et leur sincérité. A l’occasion du centième anniversaire de l’événement, dans une tentative de clore un dossier dont les développements principaux sont à présent sans mystère, Etienne Lesourd a eu l’idée de mêler les textes des uns et des autres – sans s’interdire évidemment de rectifier leurs récits lorsqu’ils sont erronés ou fallacieux. Favorable aux insurgés, le compilateur espère ainsi atteindre à une certaine objectivité, mais pas à l’impartialité, et aussi, d’une certaine façon à en finir avec Cronstadt.
Textes assemblés par Etienne Lesourd.
Prix : 12.50€
Lire un extrait
Lire un extrait
Postface :
Cent ans après : l’Espoir raisonné d’un socialisme libertaire
La révolte des marins éclata donc peu après une série de mouvements de grève à Pétrograd et en même temps que le Xe congrès du PCR qui décidera, à son issue, le lancement de la Nouvelle Politique économique (NEP) et l’interdiction des fractions dans le parti – un des derniers lieux de discussion libre dans la république soviétique. Evidemment, les quatre événements sont étroitement liés. En mars 1921, la Russie vient de sortir de la période du « communisme de guerre », après avoir surmonté l’épreuve de la guerre civile. Mais la famine rôde, l’Etat rationne la population, arrache les céréales aux paysans. Tout manque dans l’industrie : les matières premières, le combustible, les personnels compétents… Le Parti communiste règne sans partage, appuyé sur la Tchéka. Les autres partis socialistes ou anarchistes sont muselés, et nombre de leurs militants emprisonnés ou exilés, quand ils n’ont pas été fusillés. Le mécontentement règne un peu partout : chez les paysans mais aussi chez les ouvriers d’usine, pourtant base sociale revendiquée du régime. Les organisations de masse apparues lors de la révolution de Février (soviets, comités d’usine, syndicats) sont désertées par les travailleurs et/ou intégrées dans l’appareil du nouvel Etat. Les ouvriers sont plongés dans l’apathie, luttant pour rester en vie, et ont abandonné de fait, mi-forcés mi-résignés, la conduite des affaires du pays aux bolchéviques.
Pourtant, la pièce n’était pas jouée d’avance. Jusqu’à la révolution, le POSDR considérait encore globalement l’accommodante sociale-démocratie allemande comme un modèle et ne différait guère des autres partis européens que par la clandestinité que lui imposait l’autocratie tsariste. Il apparaissait même modéré comparé au Parti socialiste-révolutionnaire qui décimait à coups d’explosifs la haute noblesse. Dans les premières semaines qui suivent Octobre, le pouvoir communiste, Lénine particulièrement, encourage pourtant les initiatives des comités d’usine dans une période de désorganisation administrative et économique, provoquée par les avancées des armées germaniques, qui réduisent grandement l’étendue du nouvel Etat. Il ne s’agit dans l’esprit du chef du parti que de contrôler la production, surveiller les directions des usines et les personnels techniques et administratifs : la gestion ouvrière proprement dite étant hors de portée – on s’en aperçoit rapidement – d’un prolétariat arriéré, encore marqué par ses récentes origines paysannes. Mais même cette feuille de route minimale se révèle peu praticable, le pouvoir central devant arbitrer constamment entre, d’une part, les nécessités impérieuses de la planification et de la centralisation et, de l’autre, l’esprit de clocher des ouvriers qui ont souvent tendance à considérer l’usine dans laquelle ils travaillent comme la leur propre. Lénine lui-même change bientôt d’opinion sur l’autogestion. Quant aux fonctionnaires et aux dirigeants du nouvel Etat, ils ont naturellement tendance, selon la loi des oligarchies, à passer outre les quelques velléités d’initiative des soviets ou des comités d’usine, ainsi que leurs souhaits ou leurs réticences. Notons tout de même que ces développements avaient été assez tôt prévus par les « communistes de gauche » en 1918 au moment du traité de Brest-Litovsk qu’ils refusaient. La position – un moment majoritaire dans le parti – était intenable, mais les prédictions étaient exactes. Ces militants le vérifieraient un jour à leurs dépens.
De communisme (« A chacun selon ses besoins »), il n’était évidemment pas question, mais de socialisme (« A chacun selon ses moyens ») non plus. La période du « communisme de guerre » (environ de 1918 à la fin 1920), marquée par l’étatisation de toutes les entreprises, l’interdiction du commerce privé, le monopole d’Etat sur le blé et la plupart des produits de première nécessité, avait été imposée par la nécessité. Elle ne différait que dans son étendue du « socialisme de guerre » appliqué en Allemagne pendant la guerre mondiale. L’Etat organisait et distribuait, en principe égalitairement, mais pas toujours effectivement, la nourriture disponible. Les bolchéviques aimaient rappeler cette anecdote selon laquelle le ministre du Ravitaillement lui-même, Tsiouroupa, était tombé d’inanition lors d’une réunion du gouvernement. Mais on a vu aussi dans les extraits que l’on vient de lire que des ouvriers soupçonnaient Kalinine, chef de l’Etat en titre, de toucher autant de rations qu’il exerçait de fonctions… Seuls quelques dirigeants, dont Boukharine, Noguine et Tsiouroupa lui-même, refusaient de toucher des suppléments de nourriture dus à leurs hautes fonctions, jusqu’à ce que Lénine leur ordonne de les accepter.
La révolte des marins n’était donc pas dépourvue de raisons. Elle suivait un mouvement de grèves dans les usines de l’ancienne capitale impériale, lequel cependant ne rejoindra pas les insurgés. De fait, le pouvoir bolchévique restait sinon soutenu, du moins toléré, faute de mieux, par une majorité du prolétariat industriel, considérant qu’il était le seul à même, dans les circonstances présentes, d’assurer un minimum d’approvisionnement alimentaire aux masses des villes et un minimum de production industrielle. On a vu, d’ailleurs, comment le pouvoir désamorça ce mouvement, dans une valse-hésitation entre concessions sur le plan alimentaire et répression.
La révolution était mal partie.
Selon la théorie marxiste, une révolution socialiste ne pouvait survenir que dans des pays où la composante ouvrière était majoritaire, au moins relativement (c’est d’ailleurs l’évidence), et là où l’économie avait atteint un certain niveau d’organisation technique, où la main d’œuvre avait montré sa capacité de mobilisation et sa conscience politique. Or ces deux dernières conditions n’étaient réalisées qu’à Moscou et à Pétrograd. Il est à noter toutefois que dans cette dernière ville, les industries, plus récemment installées, présentaient parfois des formes plus modernes qu’en Europe. Mais la classe ouvrière russe ne constituait qu’une minorité noyée dans un océan de paysannerie. Et il était clair qu’elle était dans l’incapacité de prendre en main la production, à cause notamment de la disproportion entre ses compétences techniques et celles des spetsys, c’est-à-dire les « spécialistes bourgeois » : techniciens et ingénieurs. Tout au plus, on l’a dit, certains comités ont-ils pu exercer une forme de contrôle sur la marche de leurs usines – et quelquefois, il est vrai, assurer une production minimale.
Incapable de prendre en main l’économie, le prolétariat industriel n’avait pas plus de prise sur la politique face à un pouvoir qui jugeait que dans ces circonstances il était fondé à gouverner provisoirement au nom, et à la place, du prolétariat. Mais, si la classe ouvrière ne gouvernait pas, qui donc le faisait, sinon une « aristocratie communiste » issue majoritairement de la petite-bourgeoisie ? Ce qui était d’ailleurs conforme aux idées de Lénine, exposées dans Que faire ?, selon qui la conscience socialiste ne peut être insufflée à la classe ouvrière que par les intellectuels. Le socialisme n’était plus présent que dans la possession par l’Etat des moyens de production et aussi par la volonté sincère du groupe dirigeant d’étendre la révolution vers l’Allemagne, ce qui aurait certainement changé la suite des événements si la chose s’était accomplie. Et ce n’était pas la NEP, avec la réintroduction contrôlée du capitalisme, qui allait arranger les choses et restaurer la démocratie socialiste.
Notons ici que ce concept de « dictature du prolétariat », forgé par Marx, selon lequel une classe dominée économiquement, et donc socialement, pourrait imposer sa volonté politique à la classe dominante, n’est pas sans poser problème, d’un point de vue matérialiste même. En fait, on ne la vit jamais s’exercer nulle part, même dans les régions où la classe ouvrière était forte et organisée. Les troubles sociaux d’après la Ire Guerre mondiale ont touché tous les Etats belligérants (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Autriche, Hongrie…), mais ils ont été surmontés assez facilement par les bourgeoisies des Etats « victorieux ». Les seules tentatives anticapitalistes d’envergure eurent lieu en Allemagne, pays où le prolétariat était le plus avancé techniquement, organisationnellement et intellectuellement, mais l’effondrement de l’Etat impérial, suite à la défaite militaire, fut plus décisif que la mobilisation ouvrière. Les divers soulèvements s’y firent en ordre dispersé, s’échelonnant sur quatre années. La majorité de la classe, suivant les sociaux-démocrates, se contentera finalement de l’établissement d’une république bourgeoise.
Dans l’Espagne soulevée après le pronunciamento des généraux en juillet 1936, des militants anarchistes purent remettre en marche assez souvent plusieurs usines avec ou sans la participation des cadres et des ingénieurs. Il y eut aussi l’aventure des collectivités agricoles, en Aragon principalement. Mais de fait les milices libertaires servirent aussi de bras protecteur à la république bourgeoise – qui n’aurait pas survécu au putsch franquiste sans elles. Les choses auraient-elles été différentes si, comme le pensaient certains à l’époque, les milices s’étaient attaquées à l’ensemble de la bourgeoisie et combattu les troupes gouvernementales aussi bien que les franquistes ? Ce n’est pas impossible. Pour sa part, le courant trotskiste (peu présent en Espagne) donne comme cause principale de l’échec l’absence d’un parti révolutionnaire bien implanté parmi le prolétariat des villes et des campagnes. Les libertaires leur répondent que la défaite était surtout due à la présence d’un parti contre-révolutionnaire, très bien organisé, lui, et financé par l’Union pseudo-soviétique : le Parti communiste…
En fait, les seuls partis communistes qui au cours du xxe siècle réussirent à éliminer l’ancienne classe dirigeante et à abattre le capitalisme privé (sans pour autant fonder des sociétés socialistes) ne purent le faire qu’appuyés sur la paysannerie, dans des pays arriérés où la classe ouvrière n’existait quasiment pas. Dans les pays plus riches, ces partis se sont fatalement social-démocratisés (dès le milieu des années 1930 en France), glissement réformiste camouflé par l’allégeance à l’URSS. Les classes ouvrières se sont refusées dans leur majorité au communisme. Bien sûr, le bilan humain du stalinisme, dont la répression de Cronstadt fut le sinistre présage, y fut pour beaucoup. Le sentiment dominant était que oui, de telles révolutions étaient possibles, voire utiles, mais uniquement dans les pays pauvres… Ce qui s’est révélé assez conforme à la réalité.
Au total, le mouvement ouvrier n’a donc pas tenu les promesses qu’on avait mises en lui, ni les buts révolutionnaires qu’il s’est parfois fixés, ici ou là. La menace du « grand soir » (et de l’armée Rouge), quand elle semblait encore revêtir quelque consistance, aura surtout servi d’aiguillon modernisateur du système et permis aussi d’améliorer notablement la condition ouvrière dans les pays capitalistes.
La République universelle.
De nos jours, le prolétariat privilégié par la théorie marxiste (les ouvriers d’industrie), s’est numériquement réduit, surtout dans les pays développés, tandis que la paysannerie reste dominante en Chine et surtout en Inde, par exemple. Certes, si l’on inclut les employés, les petits cadres, les pseudo-« auto-entrepreneurs », les paysans pauvres…, on peut aussi considérer qu’il s’est étendu. Mais le capitalisme fait la preuve tous les jours de sa nocivité criminelle, avec son « terrible cortège » de famines récurrentes, sous-alimentation de centaines de millions d’humains, pillage des ressources, guerres incessantes, catastrophes de moins en moins naturelles en augmentation constante, exils forcés des populations, pandémies, menace nucléaire… Son abolition, et non sa seule réforme, dont il montre constamment qu’il en est incapable, n’est plus seulement une question de justice sociale, mais de survie de l’humanité.
Toutes les menaces qu’il porte ne peuvent être conjurées que globalement, dans le cadre d’un Etat mondial, évidemment fédératif – soit le vieux rêve de la République universelle. En attendant, la conclusion d’alliances anticapitalistes entre prolétaires (au sens large du terme) et classes moyennes, entre ceux qui redoutent la fin du monde et ceux qui ne sont pas sûrs d’arriver à la fin du mois, apparaît indispensable. Ces derniers devront, si la chose se réalise, exercer leur surveillance vigilante, sinon leur dictature, sur les premiers dans des sociétés « socialisantes », mais qui laisseront subsister une part de petites entreprises privées. Une sorte de NEP sans capitalistes, en quelque sorte, transition vers un communisme frugal, économe en ressources naturelles, en productions industrielles et en travail aussi, dont on peut espérer que les avancées technologiques permettront d’éviter à ses bénéficiaires les affres d’une pesante bureaucratie. Evidemment, cela ne se fera pas tout seul et ne surviendra sans doute qu’au terme d’une série de bouleversements d’ampleur, en tout genre. Ceux qui tiennent les clés du pouvoir et des richesses ne les rendront pas de bonne grâce. D’ores et déjà, leurs fondés de pouvoir se mettent en ordre de bataille un peu partout dans le monde en renforçant surveillance et répression policières. Socialisme ou barbarie !, l’actualité de cette alternative n’a jamais été aussi brûlante.
Les éditeurs.