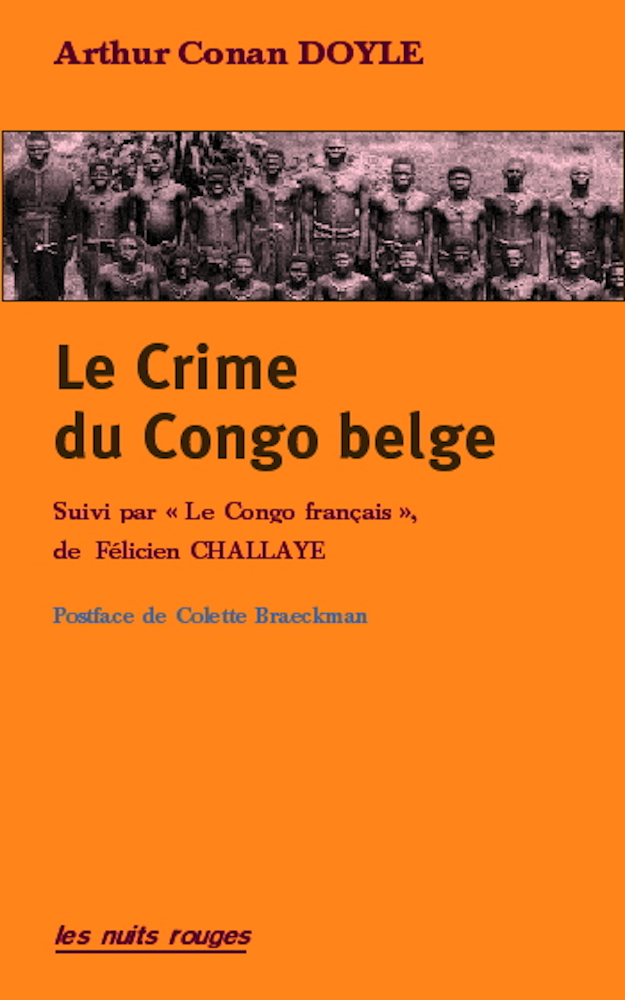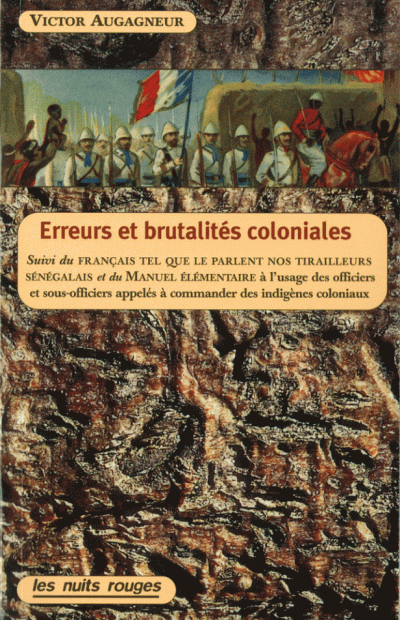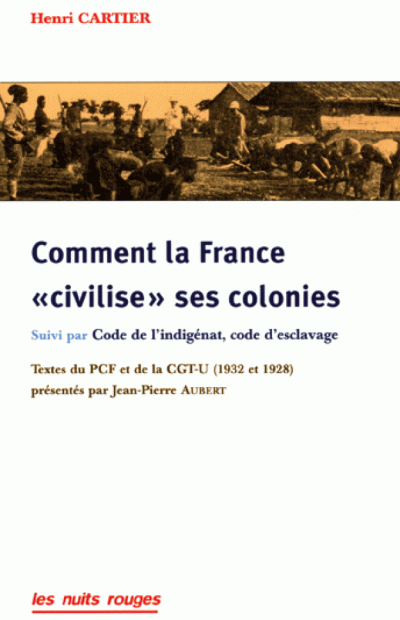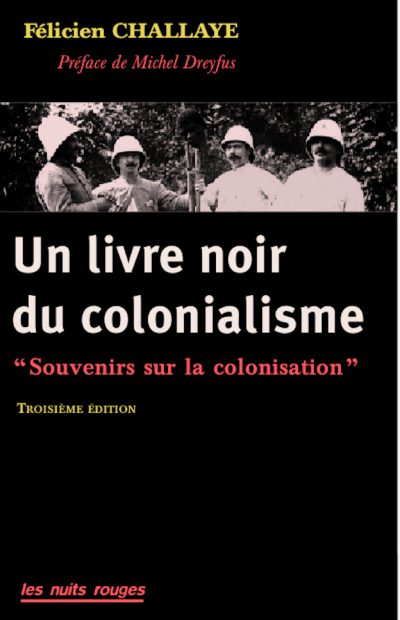Le Crime du Congo belge
Contrairement à ce que son titre peut laisser croire, ce texte n’est pas une aventure inédite de Sherlock Holmes, mais un pamphlet de son créateur qui voulut enquêter lui-même sur les massacres et atrocités perpétrés entre 1885 et 1908 dans « l’Etat indépendant du Congo », propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II. La rapacité du roi et des compagnies concessionnaires entraîna l’asservissement des paysans congolais, mobilisés pour « faire du caoutchouc ». Plusieurs millions d’entre eux y laisseront la vie, assassinés, affamés ou rendus malades. L’opinion mondiale retint surtout ces clichés d’enfants aux mains coupées, celles que les tirailleurs de la Force publique ramenaient aux officiers blancs pour évaluer le nombre de leurs victimes et prouver qu’ils n’avaient pas gaspillé leurs cartouches à la chasse… Tout comme à cette époque Félicien Challaye, secrétaire de Brazza lors de son inspection menée sur la rive « française » du Congo en 1905, Doyle se réclame d’un colonialisme soucieux de l’ « amélioration de la condition des races indigènes », et peut-être plus encore de la « liberté du commerce ». C’est-à-dire, dans sa conception, celui que pratiquaient les Anglais – oubliant la quasi-extermination des premiers Australiens – et, dans une moindre mesure, les Français, bien qu’ils eussent adopté l’essentiel du système léopoldien dans leur colonie congolaise, où le pillage des ressources caoutchouteuses, quoique moins abondantes, était aussi intense. C’est ce qui ressort du texte implacable de Challaye, publié par Charles Péguy en 1906 dans ses Cahiers de la quinzaine, malgré la modération de son expression.
Postface de Colette Braeckman.
Prix : 14.00€
Lire un extrait
Lire un extrait
Présentation de l’éditeur
Les deux textes que l’on va lire sont à peu près inconnus en France. Si la chose n’est pas étonnante s’agissant de Félicien Challaye, anticolonialiste endurci qui ne rechercha jamais la célébrité, elle l’est plus pour Arthur Conan Doyle, gloire mondiale du « roman criminel », comme on disait autrefois. Il faut dire que, sauf erreur, aucune bibliothèque française – y compris la Nationale – ne possède le livre, que ce soit la version originale, publiée en 1909, ou la version française, parue l’année suivante chez l’éditeur parisien Félix Juven, qui avait publié quelques « Sherlock Holmes ». Il faut convenir que cette mise en accusation solennelle du régime de terreur léopoldien (« Le plus grand crime de tous les temps ») semble trancher avec le reste de l’œuvre de ce conservateur bon teint, qui devint spiritiste sur ses vieux jours. Mais il faut savoir que Doyle a écrit d’autres ouvrages historico-politiques, qui ne sont pas plus connus ici, et qu’il n’était pas opposé au colonialisme, tout au contraire.
Né à Edimburg en 1859, il avait bourlingué un peu dans sa jeunesse. Il fut ainsi médecin de bord d’un navire qui cabotait le long des côtes africaines. Mais, atteint de la malaria à Lagos, il fut rapatrié au bout de quelques mois. En 1896, il couvrit comme correspondant de guerre la meurtrière opération anglaise contre les derviches soudanais. Pendant la deuxième guerre des Boers, il dirigea brièvement un hôpital à Bloemfontein en 1900. Rentré en Angleterre, il rédigea deux récits, tous deux favorables à l’Angleterre : The History of the Great Boer War, en 1901, et The War in Southern Africa : Causes and Conducts, l’année suivante, qui récusait les accusations d’atrocités formulées, au Royaume-Uni même, contre l’armée anglaise (voir note p. 196). Ce qui lui valut l’anoblissement. Favorable à l’impérialisme, dans le sens non péjoratif que le mot avait à l’époque, Doyle était aussi un homme qui prenait au sérieux les idéaux de démocratie, du moins tant qu’ils n’entraient pas en contradiction avec les intérêts de son pays. En 1906, le nouveau « Sir Arthur », malencontreusement battu aux élections législatives dans sa ville natale en janvier, mena une première campagne pour établir l’innocence d’un jeune notaire indien, George Edalji. Condamné en 1903 à sept ans de prison sous les accusations extravagantes d’avoir envoyé des lettres anonymes et mutilé du bétail, l’homme sera libéré. En 1910, Doyle récidivera pour éviter la peine de mort à Oscar Slater, un Allemand d’origine juive accusé de meurtre. Mais son innocence ne sera reconnue qu’en 1927.
C’est en 1909 que Doyle s’engage dans la campagne menée par deux hommes courageux, Edmund Dene Morel, employé d’une société de négoce de Liverpool, et Roger Casement, consul anglais témoin des atrocités du Congo. Comment le premier a eu ses premiers soupçons éveillés par le fait que les bateaux qui allaient charger le caoutchouc au Congo n’emportaient que des armes et comment le second rédigea, en 1904, le rapport qui allait mener à la fin (théorique malheureusement) du régime léopoldien a été excellemment décrit par le journaliste américain Adam Hochschild *. Nous renvoyons nos lecteurs à cet ouvrage fort bien écrit qui, après les livres de l’historien belge Jules Marchal *, fit date et inspira quelques polémiques.
En plus de Doyle, qui fut la recrue la plus prestigieuse de l’association crée par Morel et Casement en 1904, la Congo Reform Association (CRA), d’autres auteurs avaient pris leur part de la dénonciation des crimes commis en ce pays. Il y avait eu la nouvelle de Joseph Conrad, Heart of Darkness (« Au Cœur des ténèbres »), parue en 1899, récit de son voyage au Congo, neuf ans plus tôt, lorsque le colonisateur n’en avait qu’après l’ivoire. Puis, en 1905, l’ironique et implacable King Léopold’s Soliloquy (« Le Soliloque du roi Léopold »), de Mark Twain. Il faut associer à ces auteurs aujourd’hui fort connus d’autres voix, telles que celle du pédagogue afro-américain Booker T. Washington, fondateur de la branche américaine de la CRA.
Malgré la virulence de la campagne anti-Léopold, qui prit bientôt une dimension européenne, ceux qui la portaient n’étaient nullement des adversaires du colonialisme, si les informations et les indignations qu’ils répandaient peuvent encore nourrir les réquisitoires contre cet épisode fondamental de la mondialisation. C’est incontestablement le cas pour Doyle, convaincu qu’il était de la mission civilisatrice des puissances européennes. Contrairement à ce que l’on croit trop souvent, ce n’était pas en France que s’exprimaient le plus de voix contre les abus de la colonisation européenne, mais dans l’Angleterre monarchique, qui avait d’ailleurs aboli l’esclavage dès 1807. Ce combat était mené souvent par des protestants dissidents, ainsi le baptiste William Wilberforce (1759-1833) qui dénonça « le commerce homicide des esclaves ». Dans la thèse économiquement libérale, défendue abondamment par Doyle dans son pamphlet, la liberté du commerce est plus efficace, moins coûteuse en vies humaines, que la force des armes et doit donc être privilégiée. Le conservateur Salisbury qui, hormis quelques brèves interruptions, dirigea la politique anglaise de 1885 à 1902, affirmait ainsi que « la Grande-Bretagne a adopté une politique de percée par le commerce ». Cette politique de domination indirecte des pays tropicaux avait été rendue possible par l’avance industrielle de cette nation sur ses concurrents européens et par l’importance de sa flotte commerciale. Possesseuse de colonies juteuses, bien administrées (Amérique, puis Inde et Afrique du Sud), elle avait peut-être un moindre besoin d’épuiser les régions et les peuples qui tombaient sous sa coupe, comme le faisaient encore les Français, les Belges ou les Portugais au début du xxe siècle. Un siècle plus tard, des auteurs français ont sublimé ce retard historique, et les horreurs qui en furent la conséquence, en opposant un prétendu « universalisme » républicain français – où, en quelque sorte, on opprime les peuples pour leur bien – au supposé « communautarisme » royaliste anglais qui laisse en place les hiérarchies traditionnelles.
Cependant, lorsque cette politique se révélait inopérante, le Royaume-Uni savait évidemment user de la force. Un des buts de la première guerre conduite contre les Afrikaners fut, face à un Transvaal qui pratiquait la « préférence nationale », l’ouverture des emplois miniers aux Africains noirs, et aussi aux Blancs émigrés (Anglais et autres), pour ainsi faire baisser les salaires versés par les sociétés qui exploitaient les gisements d’or de cette province. John Hobson, l’auteur de Imperialism, A Study (1902), écrivait franchement, dans un autre de ses ouvrages (The War in South Africa), que « cette guerre a pour but de fournir aux mines une main d’œuvre qualifiée et bon marché ».
En Inde, de très meurtrières famines ont eu pour cause la gestion colonialiste des ressources ; la dernière, qui fit plusieurs millions de vitimes, ne date que de 1943 (voir Génocides tropicaux, de Mike Davis. La Découverte, Paris, 2003). La répression de l’insurrection des Mau-Mau du Kénya, dans les années 1950, aurait fait 100 000 morts selon Caroline Elkin (Britain’s Gulag. J. Cape, Londres, 2005). On doit rappeler aussi la quasi-extermination des Premiers Australiens et, avant cela, en Grande-Bretagne même, « l’expropriation originelle » des paysans, selon l’expression de Marx. Le régime belge des monopoles commerciaux avait été pratiqué par les Anglais, en Inde et en Amérique, et avant eux par les Néerlandais. Outre-Atlantique, l’Hudson Bay Company imposait violemment ses prix aux trappeurs (français ou premiers américains) récalcitrants. Morel reconnut plus tard que si les Allemands avaient gagné la Ière guerre mondiale, ils auraient pu bâtir un dossier tout aussi solide sur les iniquités anglaises en Rhodésie et au Bechuanaland (The Black Man’s Burden. The White Man in Africa, From the Fifteenth Century to World War. 1920).
De ces crimes, Doyle ne voulait rien savoir. On notera le ton arrogant qu’il emploie parfois dans son texte, alternant avec des formulations plus diplomatiques quand il s’agit de la France. Il nourrissait en plus, comme on va le voir, quelques illusions sur le pacifisme de l’Allemagne et particulièrement de Guillaume II, le petit-fils de Victoria. Pourtant le massacre des Herreros de Namibie, là encore une quasi-extermination, ne remontait qu’à 1908. Mais qu’en savait-il exactement ?
Alors pourquoi une telle opprobre fut-elle jetée sur la Belgique, quand toutes les nations colonisatrices ont employé peu ou prou, ici ou là, et à diverses périodes, la terreur, ce préalable indispensable à l’exercice des lois moins brutales du marché ? Citons encore Hochschild : « Une des raisons pour lesquelles les Britanniques et les Américains se concentrèrent sur le Congo fut certainement qu’ils s’agissait d’une cible inoffensive. L’indignation provoquée par ce qui s’y passait ne concernait aucun crime imputable aux Anglais ou aux Américains et n’entraînait aucune des conséquences diplomatiques, commerciales ou militaires qu’auraient eues une attaque contre une grande puissance telle que la France ou l’Allemagne. » * * Si Doyle était conservateur – plus précisément unioniste, c’est-à-dire hostile au Home Rule accordé à l’Irlande en 1886 –, l’agrégé de philosophie Félicien Challaye était socialiste. Comme la majorité des militants du mouvement ouvrier de son époque, il croyait fermement en la supériorité des Européens sur les primitifs d’Afrique et d’ailleurs. Ce n’est que progressivement, devant le spectacle de ces armées civilisées qui reprenaient, parfois en l’amplifiant, la sauvagerie des peuples qu’elles voulaient domestiquer, qu’il changera sa position. Toute sa vie, il restera marqué par son voyage avec Brazza au Congo « français » en 1905, dans le cadre d’une commission d’enquête sur les abus des concessionnaires. Brazza mourra à Dakar, lors du voyage de retour, empoisonné, affirmera sa veuve. Son rapport restera enfoui dans les armoires du ministère des Colonies. Il est aujourd’hui porté « disparu ». Mais, heureusement, Challaye avait pris des notes. Si le texte de Doyle est véhément – plus même que ceux de Morel –, celui de Challaye est d’un ton modéré, et aussi plus étayé – trop même, ce qui engendre d’envahissantes notes de bas de page. Mais c’est un document important, non seulement sur l’histoire du Congo de la rive droite, les peuples qui l’habitent, les méthodes des compagnies capitalistes, et aussi sur cette obsession colonialiste du travail quotidien auquel il faut obliger ces masses africaines qui y sont naturellement rétives. Les deux textes révèlent l’identité des méthodes employées sur les deux rives du Congo. Certaines analogies de situations sont frappantes. Les deux auteurs prônent un colonialisme libéral, c’est-à-dire qui substitue l’exploitation indirecte du travail, par les moyens complémentaires de l’impôt et du salaire, à son extorsion brutale. Craignant que « la prospérité superficielle du Congo présent » ne fasse qu’assurer « la misère définitive du Congo futur », Challaye insiste sur ce point que l’intérêt des indigènes coïncide avec celui de la colonie « qui a besoin, comme main d’œuvre, d’une population nombreuse et saine ». Comment on conduisait ces populations à travailler, pour pas cher, au profit des sociétés françaises est par ailleurs précisément décrit par l’auteur : ainsi, par exemple, en interdisant aux Congolais résidant près de l’océan de récolter le sel et en les forçant à acheter aux concessionnaires un produit qu’ils avaient toujours librement récolté. Challaye est inattaquable. Il cite très précisément ses sources. Il n’idéalise pas « les indigènes ». Et on ne peut lui reprocher une acrimonie chauvine contre une puissance rivale, puisqu’il s’attaque à son propre colonialisme. Et s’il n’emploie pas le mot « crime », il parle de « faute criminelle ». Mais, bien sûr, son texte a ses limites : à cette époque, l’auteur était encore persuadé de « l’intelligence médiocre » des Congolais (voir la préface de Michel Dreyfus à notre édition de ses Souvenirs sur la colonisation * de 1935). Quel fut l’impact de la campagne des réformateurs sur la condition des Congolais ? Côté belge, comme le rapporte Doyle, les atrocités commencèrent à décroître après la récupération du Congo par la Belgique. Cependant, Jules Marchal et d’autres ont montré que le travail forcé perdura jusqu’après la seconde guerre mondiale et qu’il connut même un nouveau pic pendant celle-ci, vu la demande importante en minéraux, caoutchouc et autres produits (voir p. 301 la postface de Colette Braeckman). Côté français, des abus, des recrutements et des enrôlements forcés, des famines provoquées par le régime colonial, s’abattront jusqu’à la même date sur les Africains, et dans tout l’empire. Précisons que le travail forcé ne fut – théoriquement – aboli, qu’en 1946 (voir le discours d’Houphouët-Boigny dans notre Livre noir du colonialisme *). Sur cette question, nous renvoyons à Challaye ou aux travaux de Jean Suret-Canale et Catherine Coquery-Vidrovitch *, et d’une manière générale aux textes anticolonialistes des années 1950-60. Mais il reste encore beaucoup à apprendre et à dire sur cette période, qui connaît cependant un regain d’intérêt de la part de jeunes historiens, sous l’attention sourcilleuse des banlieues de la république. Et cela d’autant plus que le système des concessions, loin d’avoir disparu, semble reprendre du poil de la bête en ce début du xxi e siècle. Au Libéria, une grande compagnie étatsunienne de pneumatiques utilise les enfants-soldats démobilisés comme gardes-chiourmes dans ses plantations d’hévéas. Des Etats asiatiques et africains organisent le travail forcé au bénéfice de transnationales pétrolières, installées sur leur territoire comme en pays conquis. La presse a aussi évoqué rapidement, en 2005, le cas de travailleurs philippins retenus dans une base nord-américaine en Irak… Ce ne sont que quelques exemples. Au Congo, les causes de la fin de la première période massacrante du colonialisme sont à rechercher probablement dans les ouvrages, les articles, les manifestations de toutes sortes contre ces abus. Mais elles résident encore plus dans l’épuisement des ressources de caoutchouc sauvage et l’introduction subséquente de plantations capitalistes d’hévéas, intervenues vers 1910. Sur la question du « coût humain », les estimations varient fortement comme chaque fois que les historiens sont confrontés à des massacres de grande ampleur. Morel arrêta à 10 millions le nombre de Congolais « belges » assassinés pour la période 1890-1910. Hochschild retient le même chiffre, mais pour les quarante premières années de colonisation. Côté français, le même auteur écrit que « des milliers de réfugiés qui avaient passé le Congo pour échapper au régime léopoldien finirent par le retraverser pour échapper aux Français ». Au total, il estime que « la perte de population dans la forêt équatoriale, riche en caoutchouc, est estimée, exactement comme dans le Congo de Léopold, à 50 % ». Isidore Ndaywel è Nziem * écrit qu’ « entre 1880 et 1908, environ 13 millions de vies humaines furent détruites ». Même Stephen Smith (Négrologie. Paris, 2003) croit que le Continent noir « a perdu entre un tiers et la moitié de sa population, les pertes les plus élevées étant enregistrées en Afrique centrale et orientale » entre 1880 et 1920, « bien plus que l’ensemble des traites pendant des siècles ! ». Plaidant pour la défense, et en se limitant à la partie belge du Congo, l’historien Jean Stengers * a jeté un doute sur la fiabilité des chiffres de départ fondés sur des extrapolations fautives de Stanley. Selon lui, le chiffre de 27 millions de Congolais vivant en 1880 fourni par l’explorateur est exagéré, car le Congo n’a pas partout la même densité de population que sur les rives du fleuve descendu par Stanley. Mais il n’avance aucun chiffre, tout comme les organisateurs de l’exposition La Mémoire du Congo *, tenue à Bruxelles en 2005, qui évoquent « le résultat de catastrophes épidémiques auxquelles s’ajoutaient les disruptions entraînées par les recrutements de main d’œuvre et les déplacements de population » (« Sélection de textes de l’exposition »). Dans ses Souvenirs sur la colonisation, Challaye donne lui aussi des chiffres effrayants, tout en reconnaissant qu’ils pouvent être contestés, avant de conclure sobrement que « la population du Congo a formidablement décru ».
* *
L’article de Félicien Challaye a été publié dans Les cahiers de la Quinzaine, en 1906 (12 e cahier de la 7 e série). La revue de Charles Péguy, encore un peu socialiste, avait fait paraître un peu avant une étude du journaliste Pierre Mille sur « Le Congo léopoldien » (6e cahier de la 7e série), qui fut reprise en volume. Les deux auteurs signeront ensemble quelques semaines plus tard un article sur « Les deux Congo devant la Belgique et la France » (16e cahier de la 7e série). En 1909, Challaye rassembla l’ensemble de ses notes et articles dans un ouvrage de 316 pages intitulé Le Congo français : la question internationale du Congo (Alcan, Paris). Il reprenait l’article ici reproduit, et y ajoutait le Journal qu’il avait tenu pendant son voyage avec Brazza, ainsi qu’un développement consacré aux aspects internationaux de la question, qui donnera son titre à l’ouvrage. Dans ses Souvenirs sur la colonisation (Paris, 1935), Challaye reprendra quelques extraits de tous ces textes. Quant au pamphlet d’Arthur Conan Doyle, il fut écrit en août 1909, en huit jours – ce qui se ressent un peu à la lecture. Les formulations redondantes, voire pléonastiques, ne sont pas rares. Il y a des répétitions, dues à la volonté de l’auteur de prouver la véracité des faits qu’il rapporte, et aussi quelques erreurs dans les noms que nous avons rectifiées en partie. Mais les faits révélés, la force de l’indignation, l’incontestable sincérité de l’auteur transcendent le caractère « hâtif et haché » de son texte, comme il le reconnaissait lui-même. Et d’ailleurs cet ouvrage militant, au bénéfice de la CRA, se vendit très bien. L’édition anglaise parut en octobre, chez Hutchinson (Londres), et dut être rééditée. La CRA américaine ne tarda pas à publier, chez Doubleday, Page & C° (New York), une autre version, un peu augmentée. Nous ne pouvons donner les dates exactes de ces publications intervenues à des échéances rapprochées au cours de l’automne 1909. Nous n’avons pas non plus la liste complète des traductions en langues étrangères. On sait par Marchal que Doyle finança lui-même les versions française et allemande et fit envoyer des exemplaires aux journaux et aux parlementaires belges. En janvier 1910 parut à Paris le Crime du Congo, sans indication de l’identité du (ou des) traducteur(s). A cette date, Léopold venait de mourir (le 17 décembre 1909). Doyle rédigea un « post-scriptum » où il disait son espoir de « nouveaux horizons » ouvert par cet événement et avertissait qu’il en « autorisait la publication, mais qu’ « en présence de la mort », il avait « adouci certaines allusions ». Il a ainsi supprimé, entre autres choses, quelques pages dans lesquelles il exposait un plan un peu délirant, quoiqu’annonciateur de développements futurs, pour venir à bout du Congo léopoldien (voir p. 209 et suiv.).
Notre traduction signale (par des losanges ◊) les variantes des trois éditions anglaise, américaine et française. Elle intègre également les précisions introduites dans l’édition Juven quant aux valeurs monétaires exprimées en francs, sans savoir toutefois s’il s’agit de francs belges ou français.